Cet article, paru en 1950 dans Le Chasseur Français, décrit la pêche de l’étrille durant cette décennie.
📰 L’étrille
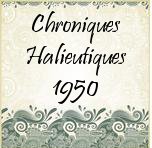
Avec le tourteau ou poupard, dont nous parlerons quelque jour, l’étrille constitue l’un des plus délicats échantillons de l’espèce crabienne. Sur les côtes rocheuses de l’Atlantique ou de la Manche, on peut commencer à pêcher utilement ce crustacé dès mars et jusqu’à fin septembre. Mais, avant de prendre le large, à pied, pour l’y cueillir, peut-être conviendrait-il d’apprendre à la distinguer de ses congénères. Tous les crabes, y compris le tourteau, possèdent une carapace lisse, à l’exception de l’étrille justement. Premier moyen de discrimination. Seule l’étrille se couvre d’une cuirasse rugueuse, très facile à reconnaître au toucher, même à la vue. De là sans doute provient son nom le plus courant, renouvelé de l’outil d’écurie. Mais on l’appelle aussi, selon les régions, liret (un liret quasi anagrammatique), ou crabe laineux, crabe velu, crabe anglais, voire anglette : d’ingénieux onomatologues affirment que cette désignation, très employée dans la Manche, date du siècle dernier, à l’époque où les soldats d’Albion étaient tout de rouge vêtus et du même rouge que l’étrille cuite.

Car, avant le court-bouillon, cet estimable crustacé offre un tout autre aspect, vous vous en doutez. La couleur générale de la bête va du gris rougeâtre au gris bleuté, selon les varechs où elle vit, très nettement différente de celle de tous ses autres congénères, qu’il s’agisse des crabes gris, verts ou rouges, d’une valeur comestible des plus discutables. Sa configuration générale est sensiblement celle du crabe ordinaire, à cela près que l’étrille est pourvue, à l’arrière de sa carapace, de quatre pattes natatoires plates, deux de chaque côté, et que ses deux pinces antérieures, dentelées comme celles du homard, sont d’une mobilité étonnante.
Telle vous apparaîtra l’étrille, en quelque coin des côtes que vous l’alliez pêcher. Il importera avant tout de bien apprendre à la reconnaître. Elle seule vaut qu’on la prenne, mais le vaut largement : la délicatesse de sa chair, qui s’apparente à celle du homard, la qualité de sa « farce » ou « terrinée », du moins lorsque l’animal est bien plein — une farce compacte, d’un jaune clair, — vous récompenseront amplement, vous et vos convives, de la peine que vous aurez dû prendre à la cueillir. Car, si le crabe courant, même le tourteau, se laisse appréhender à peu près sans combattre, il n’en va pas de même de l’étrille, prompte à l’attaque et de défense rapide. Donc attention à ses pinçures, peu dangereuses, certes, mais jamais agréables ; attention aussi à ses prestes réflexes comme à la vitesse de sa fuite en éclair ! Notez à ce propos qu’il vous arrivera d’en rater couramment quatre sur cinq, à l’époque de vos débuts, et ne vous en découragez point. Tandis que le crabe vulgaire vit généralement sur le sable, où d’ailleurs il pullule, dans la mesure où précisément on en fait fi, l’étrille ne se rencontre jamais que sur des fonds rocheux, plats le plus souvent, et toujours pourvus d’herbes marines, particulièrement de varechs courts. Cette règle ne souffre pas d’exception.
Sur la plupart des côtes de France — mais ceci n’est pas absolu, — ces fonds rocheux ne se découvrent guère qu’en très fortes marées, par conséquent aux environs de la nouvelle et de la pleine lune. L’étrille étant peu nomade et ne se renouvelant donc point pour un emplacement considéré, on aura intérêt à entrer en campagne (sous-marine) les deux ou trois jours qui précèdent chaque lunaison et chacun de ses pleins : c’est presque à coup sûr dans les premiers jours où la mer commence à « bien découvrir » que l’on remportera les victoires les plus nombreuses.
Ceci établit, par voie de conséquence, les dates les plus favorables pour la pêche à l’étrille : elles s’inscrivent ce mois-ci, par exemple, entre le 2 et le 5, puis entre le 16 et le 19. L’indispensable consultation d’un annuaire des marées déterminera automatiquement les diverses autres dates fructueuses jusqu’à l’automne, en même temps qu’elle fixera l’heure prévue de votre départ : la pêche à l’étrille exigeant un large découvert des zones marines, on ne pourra jamais l’entreprendre que deux heures avant la basse eau, quitte à continuer la cueillette dans la première demi-heure du flux au plus tard.
Ainsi préparés, et la hotte ou le panier au dos, il ne vous reste plus qu’à connaître les modes de pêche de l’étrille.
Cette chasse d’un genre spécial peut s’effectuer aussi bien à pied sec, à quelque 200 mètres en arrière de la ligne de retrait des eaux, que dans des mares peu profondes ou en pleine eau, dans le flot descendant. Mais les débutants auront intérêt à ne pratiquer que la pêche à découvert, la plus aisée — pas si facile pourtant.
On retiendra que, dès assèchement des plateaux, l’étrille, se sentant au sec, donc quelque peu désarmée en raison de la surprenante rapidité de sa nage, s’empressera de se réfugier dans le premier abri venu : soit dans les anfractuosités d’un rocher, soit sous de larges pierres plates d’un diamètre oscillant entre 20 et 30 centimètres en général. Cette particularité dictera le choix de l’instrument de travail le mieux approprié : le croc. Un croc emmanché d’un bout de bois que le pêcheur tiendra constamment à la main et qui lui servira à arracher l’étrille à son trou, le plus souvent à soulever les pierres sous lesquelles elle se sera nichée. À la rigueur, un simple tisonnier de cuisine fera l’affaire, sans suppléer toutefois aux multiples services que rendra le crochet.
La méthode la plus sûre consiste à retourner ces pierres d’un coup sec, en direction de la mer ou latéralement, pour débusquer plus vite votre gibier, jamais par devers soi, pour éviter de recevoir la pierre sur le pied. Il faut cependant se garder de laisser retomber le caillou sur sa base, opération qui risquerait d’écraser une étrille incertaine du sens de sa fuite. Presque toujours, l’étrille ainsi délogée s’enfuit aussitôt, se dépêchant de rallier la mare ou le ru le plus proche, animée d’un subtil instinct de conservation et d’une étonnante rapidité de mouvements.
Il est nécessaire de faire très vite pour la ramasser, et beaucoup plus que vous ne le pensez. Les professionnels ou les amateurs entraînés, par conséquent endurcis, n’hésitent jamais à coiffer l’étrille à pleine main, au risque d’une pinçure. Les débutants pourront s’initier à cet utile mode de capture en se gantant de gros cuir, ce qui fait toujours bien rire les marins. Les timorés ne manquent pas de doubler leur croc, ou leur tisonnier, d’une paire de pincettes de cheminée, curieuse transposition neptunienne de leur attirail culinaire. D’autres se munissent d’une épuisette, dont ils se servent pour emprisonner l’étrille sans danger. Mais ces complications retardent toujours la capture du crustacé — quand elles ne favorisent pas en fait sa fuite.
Je conseille, par contre, l’emploi de l’épuisette à qui voudra pêcher l’étrille en mare peu profonde, des mares larges s’entend, non de petits trous emplis d’eau de mer. Là, on utilisera encore et toujours le crochet pour déplacer les pierres, mais on constatera que l’étrille s’envole dans l’eau (le terme est plus juste qu’on ne pense) bien plus vite encore qu’elle ne s’enfuit sur le sol. On aura, dans ce cas, intérêt à cueillir l’étrille par en dessous, au moyen de l’épuisette. Les véritables étrilleurs savent capturer l’anglette à la main, en pleine nage, mais ce procédé exige alors une grande sûreté de vision en même temps qu’une saine appréciation de l’indice de réfraction de l’eau salée. Si on le pratique dans le reflux même, cela devient un véritable sport, ainsi que vous le pourrez constater.
Tels sont les moyens les plus courants de pêcher « l’étrille pour l’étrille ». Sans doute, en certaines saisons, singulièrement dans les années chaudes et s’agissant de secteurs riches en crustacés de cette espèce, il est loisible de pêcher l’étrille à la bourraque ou au pousseux (le grand havenet en demi-cercle), en même temps que le bouquet. Mais ce n’est jamais là qu’un à-côté de la pêche à la crevette rouge. Et il demeure peu recommandable d’enfermer dans un même panier étrille et bouquet, la première se montrant friande du second.
Quelques conseils encore, pour en finir avec ce délicieux crustacé, si apprécié des gourmets. Les étrilles les plus grosses se capturent toujours à proximité de la limite des basses eaux. À mesure qu’on s’approche du zéro des cartes, elles croissent en volume, mais pas toujours en nombre. Les étrilles les plus pleines et les plus fines se reconnaissent à ce que leur carapace, très dure au toucher, a tendance à se disjoindre du corps, au point de jonction postérieur. Plus le sillon ainsi tracé s’accentue, meilleure sera l’étrille. Les étrilles femelles, c’est-à-dire à valve subventrale arrondie, sont exquises dans la période qui précède la ponte : elles comportent alors, tout comme les homardes, un caviar rouge d’une particulière saveur. Au court-bouillon comme à l’armoricaine, vous m’en direz des nouvelles.»
Infos source
- Source : Le Chasseur Français N°637 Mars 1950 Page 153
- Auteur : Maurice-Ch. RENARD.
- Titre : L’étrille
- Rubrique : la pêche
En Résumé
L’étrille vit sur les côtes rocheuses de l’Atlantique et de la Manche, se cachant dans les anfractuosités des roches et sous les varechs ou les petites pierres. Elle se distingue par sa carapace rugueuse et hexagonale, ses yeux rouges, et ses pattes natatoires plates à l’arrière.
La pêche à l’étrille se fait en retournant les pierres ou en cherchant dans les anfractuosités des rochers. Elle est rapide et difficile à attraper. La chair de l’étrille est délicate et appréciée, similaire à celle du homard. Les femelles sont particulièrement savoureuses avant la ponte.
Cet article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager pour informer vos proches.😊
Articles liés :
🔎 Pour enrichir ce texte ancien, j’ai sélectionné quelques images d’époque et photos personnelles qui évoquent l’ambiance ou les techniques décrites.
Article publié initialement en 2016.


